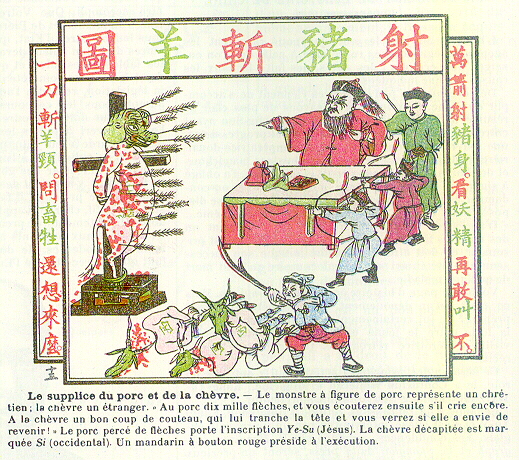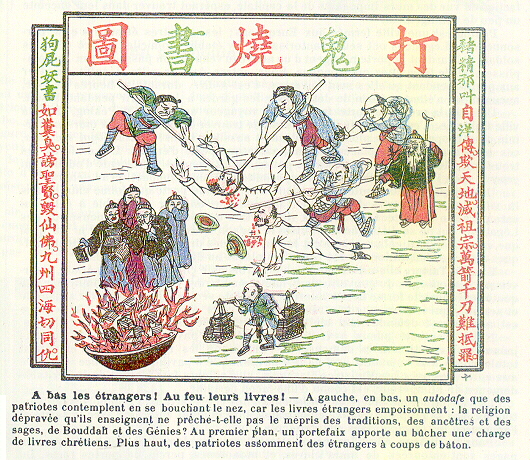La situation décrite par le magazine "L'Illustration" n'éclate pas, loin s'en faut dans un ciel serein. Si les courants xénophobes ont toujours été une composante de la vie politique chinoise, la victoire japonaise rapide et brutale remportée en 1894-1895 sur la Chine a précipité la crise politique. La guerre, née de la rivalité entre les deux pays à la cour de Corée, a mis en évidence le retard que la Chine a pris par rapport au Japon, en matière de modernisation et a ouvert la voie aux ambitions des autres puissances en Chine. Chacune des grandes puissances industrielles s'efforce alors, à l'exemple du Japon, d'obtenir de nouveaux avantages économiques. C'est la " bataille des concessions ". Entre 1896 et 1902, elles font accepter à la Chine des prêts financiers importants à des taux élevés. Elles se font reconnaître le droit d'exploiter des mines et d'ouvrir des lignes de chemins de fer, de fonder aussi des usines dans une région particulière d'où leurs concurrents sont exclus. Ce sont les " zones d'influence " : le Nord-Est (Mandchourie) au bénéfice de la Russie qui en écarte le Japon en 1896, la péninsule du Shandong en faveur de l'Allemagne, le bassin moyen du Yangzi où s'installe l'Angleterre, les trois provinces du Sud-Ouest pour la France, déjà maîtresse du Tonkin. Ces investissements financiers sont protégés par des bases militaires permanentes établies sur le sol chinois, les " territoires à bail " : Port-Arthur pour la Russie, Weihaiwei pour l'Angleterre, Qingdao pour l'Allemagne (Kiaotschou), Guangzhouwan pour la France(Kouan Tchéou Wan). Cette poussée occidentale en Chine provoque, à son tour, une violente réaction populaire. |
||||
|
||||
|
||||